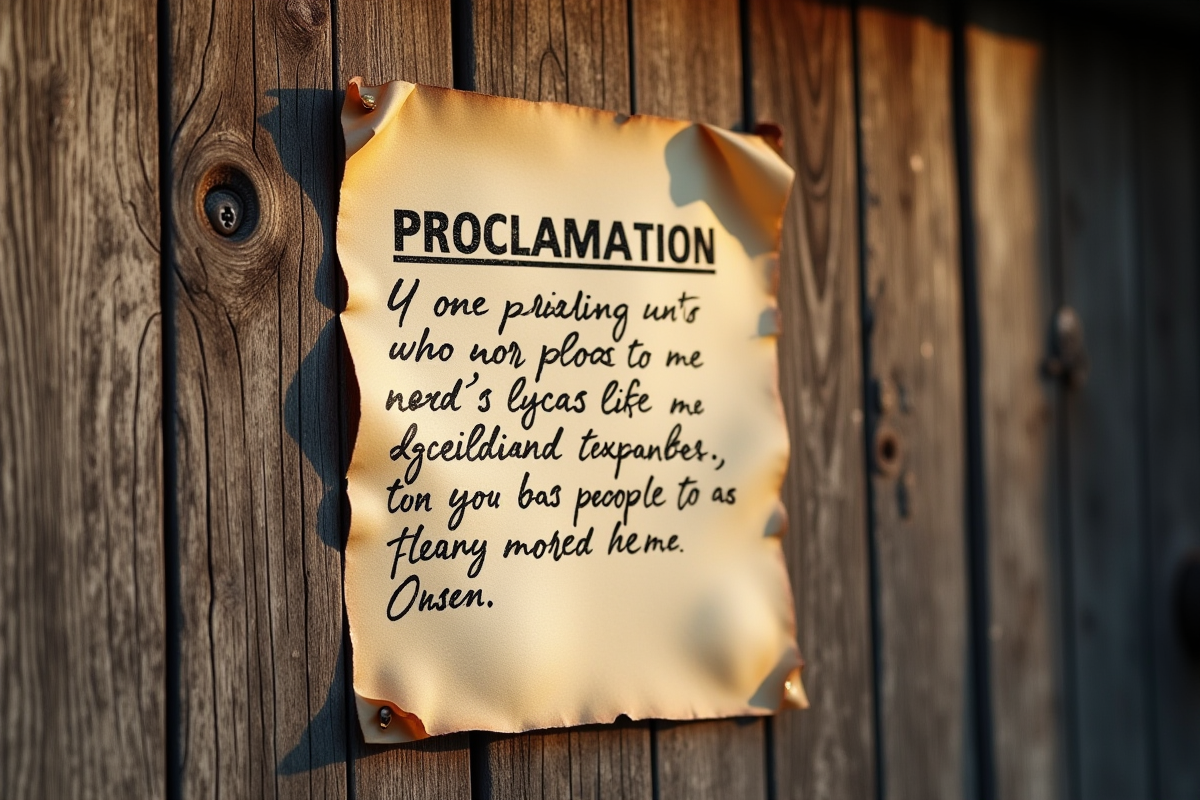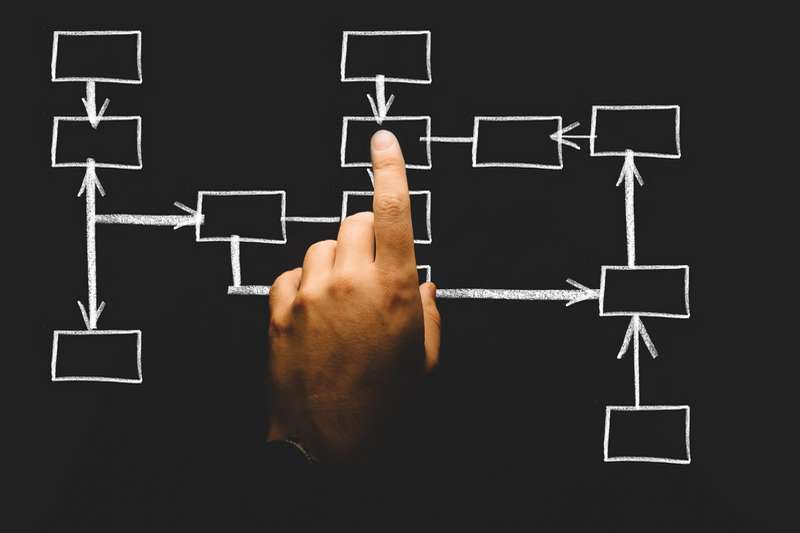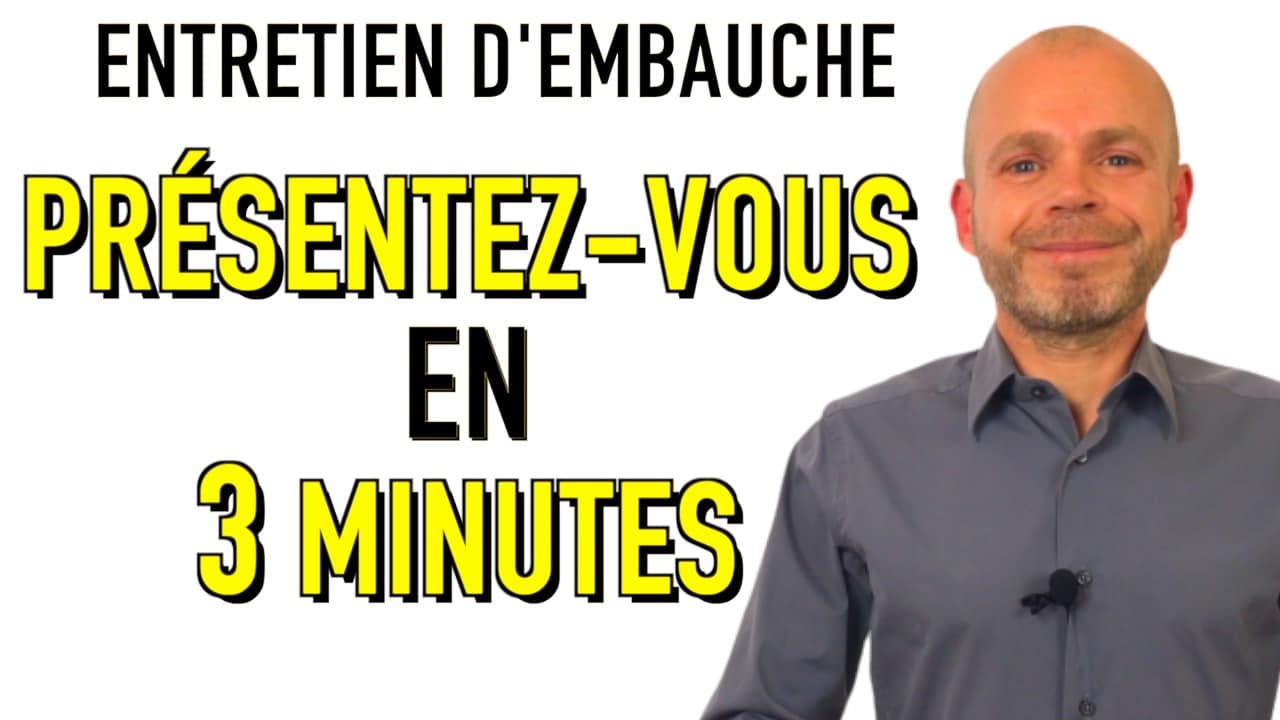En 1887, la loi française sur la liberté de la presse continue d’employer le mot « réclame ». Rien d’anecdotique : le langage officiel, la presse, le commerce, tous en font leur vocabulaire de référence. À cette époque, le mot « publicité » n’a pas encore pris l’ascendant. Le terme « réclame » désigne l’annonce qui attire l’œil, l’affiche qui occupe le mur, la mention qui s’insinue dans la conversation. Les codes sont clairs, les usages codifiés. On ne parle pas encore de campagne publicitaire, mais d’un message à faire réclamer, répéter, propager.
La transition linguistique, loin d’être homogène, révèle un paysage multiple. Les libraires, les commerçants, certains éditeurs, n’abandonnent pas si vite la vieille appellation. Le mot « publicité » progresse, mais la « réclame » s’accroche, portée par une culture, des habitudes, un imaginaire populaire. Ce chevauchement, qui persiste parfois jusque dans les années 1930, témoigne d’une adaptation lente, faite de résistances, de compromis, de réinventions silencieuses. Sous la surface, l’histoire de la publicité avance par à-coups, par petits glissements plus que par grandes ruptures.
Aux origines de la publicité : quand et comment tout a commencé ?
L’histoire de la publicité ne s’improvise pas du jour au lendemain. Ses jalons remontent à l’Antiquité, là où le commerce apprenait déjà à attirer le regard. À Herculanum, à Pompéi, des peintures murales proclament les exploits d’un gladiateur, vantent un établissement ou incitent à pousser la porte d’une taverne. Même le lécythe à figures noires du Musée du Louvre ose le message vendeur : « Achète-moi et tu feras une bonne affaire. » Les mots suivent l’intuition commerciale, bien avant d’en formaliser l’existence.
Les rues d’Alexandrie, d’Athènes ou de Rome se parent d’enseignes et de symboles colorés, bien avant l’apparition de la presse. Déjà, l’art côtoie la persuasion. Un atelier égyptien signale ses tissus, une taverne romaine s’affiche sans détour. Il suffit d’un mur, d’un peu de pigment, parfois d’un simple motif pour faire passer le message. La communication naît ainsi, rugueuse et ingénieuse, sur la céramique, la pierre ou le bois.
Un objectif prime : attirer, provoquer la curiosité ou l’achat. Cette quête de visibilité structure peu à peu les échanges : l’affiche s’installe, prépare le terrain pour ce qui, des siècles plus tard, deviendra véritablement un art à la française.
Des crieurs aux journaux : l’évolution des premiers supports publicitaires
Au Moyen Âge, le crieur public occupe le devant de la scène. Sur les places, au cœur des marchés, il proclame ordonnances, foires et produits à vendre. L’oral tient lieu de média, et les messages, scandés, chantés même, restent dans les esprits d’une population souvent sans accès à l’écrit.
À la fin du XVe siècle, l’invention de l’imprimerie bouleverse la donne. Les premières affiches publicitaires surgissent, collées aux devantures ou aux murs, annonçant événements, remèdes ou ventes à saisir. Au XIXe siècle, les Colonnes Morris, du nom de Richard-Gabriel Morris, s’élèvent dans les rues de Paris et transforment l’espace public en support d’annonce. Chaque angle, chaque palissade devient terrain à conquérir pour la communication.
L’écrit s’impose avec la presse. En 1629, Théophraste Renaudot fonde le Bureau d’adresse, avant d’ouvrir dans la Gazette les premières annonces imprimées. Un autre modèle émerge rapidement : au XIXe siècle, Émile de Girardin propulse l’annonce commerciale dans La Presse à partir de 1836. Le Figaro, vitrine grandissante, va jusqu’à tirer 37 % de ses ressources de la publicité.
Voici, pour mieux saisir la diversité des supports à l’époque, quelques exemples qui jalonnent ce parcours :
- Les murs de villes recouverts d’affiches colorées annonçant produits ou divertissements
- Les places publiques rythmées par le passage et la voix des crieurs
- Les premières colonnes installées à Paris pour accueillir messages et images destinés aux passants
- La page imprimée, terrain privilégié pour toucher un public de lecteurs de plus en plus friands d’informations
L’arrivée des artistes donnera à l’affiche ses lettres de noblesse. Jules Chéret soigne les couleurs et les mouvements ; Toulouse-Lautrec insuffle à l’art publicitaire une dimension populaire et culturelle. De Galileo à l’époque moderne, chaque nouveau support, chaque innovation, fait progresser la communication commerciale vers plus de créativité et d’impact.
Figures marquantes et innovations françaises dans l’histoire de la réclame
La France du tournant du XIXe au XXe siècle devient un terrain d’expérimentation unique. Jules Chéret invente l’affiche moderne, éclatante, vibrante. Toulouse-Lautrec, lui, immortalise cabarets et artistes par des visuels puissants, la réclame se mue en icône. L’affichage ne se contente plus d’informer : il fascine, il raconte.
Au fil du XXe siècle, de grandes agences de publicité émergent : Havas se taille une place de pionnière, suivie par Publicis en 1926. Ce sont elles qui posent les bases du métier, inventent méthodes et stratégies, structurent la profession. Déjà, la Fédération française de la publicité se constitue en 1935. La Chambre syndicale nationale de la publicité par l’objet prend aussi son envol, preuve de l’essor rapide de la publicité par l’objet, ou PPO, un support nouveau, pensé pour s’inviter partout, de la poche à la maison.
Cette dynamique s’accompagne d’une régulation de plus en plus précise. L’OCA, la BVP, puis l’ARPP prennent tour à tour la charge d’encadrer la publicité, chacune adaptée à son époque, à ses médias, à ses enjeux. Et les agences françaises ne s’enferment pas dans l’Hexagone : elles s’exportent, fusionnent, innovent, se distinguent dans la compétition mondiale.
Jusqu’aux années 1980, la régie française de publicité (RFP) orchestre la publicité à la télévision. La création, elle, gagne en subtilité et en maîtrise. Sur chaque support, la singularité française s’affirme, entre audace et volonté d’encadrer un secteur parfois trop bouillonnant pour respecter toutes les règles.
Comprendre l’héritage de la “publicité” avant l’ère moderne
Le mot « publicité » n’a pas toujours régné en maître. Avant que ce terme ne s’impose, la promotion commerciale avait déjà mille visages, alimentée par des traditions variées. L’Antiquité livre de magnifiques exemples : fresques de Pompéi sur des murs, lécythe grec au Louvre, chaque objet recelant une ambition unique, séduire, vendre, faire savoir. Ces pratiques parlent d’un temps où point de réseau, point de plan alloué, mais un esprit d’entreprise déjà affûté.
Le Moyen Âge privilégie le verbe porté à la criée et la puissance du spectacle vivant ; le peuple écoute, les places bruissent. La révolution de l’imprimerie change vite la donne : brusquement, le texte circule, s’affiche. La presse s’empare de cette nouvelle arme, notamment sous l’impulsion de Théophraste Renaudot, et la diffusion de l’annonce imprimée devient massive : l’amorce d’une communication pour tous.
Au XIXe siècle, la « réclame » infuse la langue populaire. Les journaux s’ouvrent à des encarts, l’objet du quotidien se mue en support : boutons, cocardes aux couleurs d’un parti, sacs d’école porteurs de slogans. Ce phénomène, déjà installé aux États-Unis à la fin du XVIIIe siècle, amorce ce que l’on appellera plus tard le marketing relationnel. Jasper Meek personnalise les objets, George Washington joue la carte du goodies politique. L’objet publicitaire s’impose par touches, convainc, fidélise.
Chaque époque invente à sa façon, mais s’inscrit dans un courant plus large : la publicité, loin d’une flambée soudaine, grandit sur un socle fait de tâtonnements, d’adaptations et de gestes hérités. On n’attend pas le bon mot pour faire savoir ; l’élan existait bien avant qu’on ne le nomme ainsi.
Peu importe le support, peu importe la formule : la publicité poursuit sa course, du mur antique à la bannière numérique. Une traînée de messages traverse les siècles, mais la question, elle, reste intacte : qui captera vraiment l’attention ?